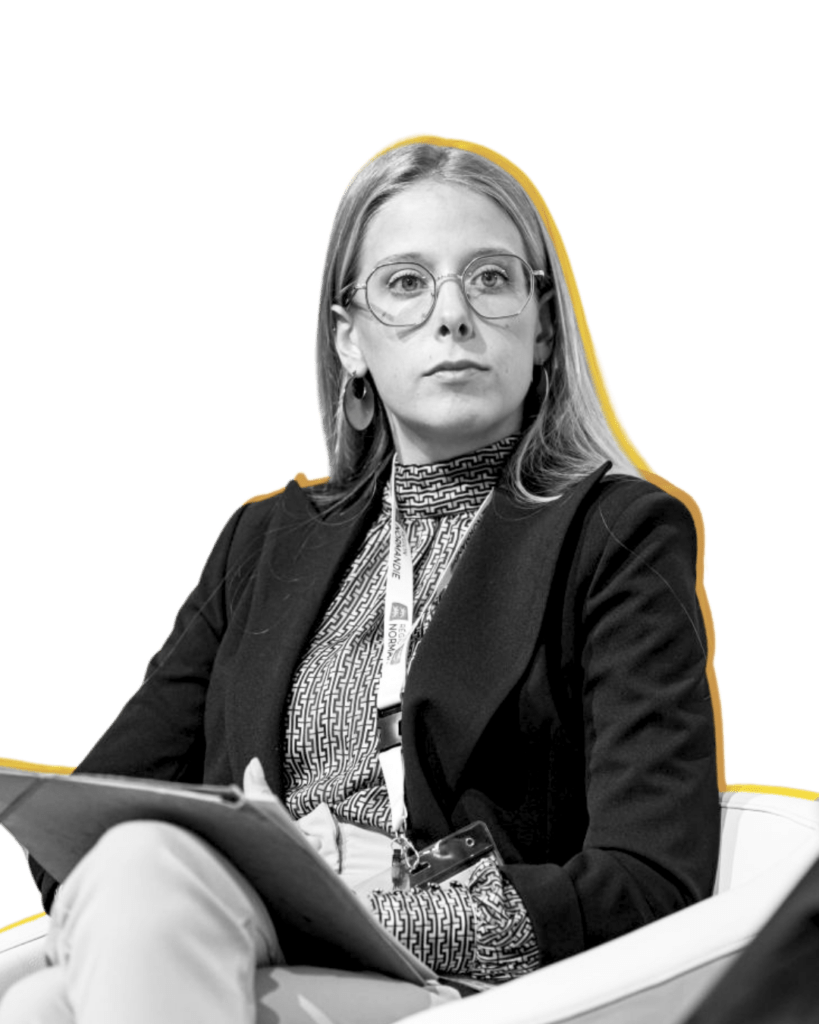Il suffit parfois de changer de regard pour que la carte du monde se redessine. Pendant longtemps, l’Afrique a été traitée comme une périphérie : une zone à stabiliser, un terrain d’opérations extérieures, un réservoir de ressources plus qu’un espace stratégique en soi. Ce temps-là semble révolu. De la Corne de l’Afrique à la bande sahélo-soudanaise, le continent attire désormais toutes les attentions — et toutes les ambitions. Bases militaires, investissements d’infrastructure, soutien aux régimes, livraisons d’armement, influence religieuse, conquêtes symboliques : la guerre d’influence ne dit pas son nom, mais elle est bien là. Et ceux qui y participent ne sont plus seulement les vieilles puissances occidentales. Russie, Chine, Turquie, Émirats, Arabie saoudite : un autre échiquier se met en place. Plus complexe, plus multipolaire, et plus ouvert aux résistances africaines elles-mêmes.
Dans cette recomposition silencieuse, la Corne de l’Afrique occupe une place singulière. Comme le rappelle Sonia Le Gouriellec, cette région longtemps négligée est aujourd’hui convoitée pour des raisons aussi stratégiques qu’économiques. Elle borde l’un des détroits les plus cruciaux du commerce mondial, le Bab-el-Mandeb, verrou de la mer Rouge et passage obligé vers l’océan Indien. Lieu de transit, donc, mais aussi carrefour militaire : Djibouti, minuscule sur la carte, héberge des bases françaises, américaines, japonaises, italiennes… et chinoises. Une première, pour Pékin. La Chine y a installé sa seule base militaire officiellement reconnue à l’étranger, marquant une inflexion nette de sa politique d’implantation. Elle complète un ensemble d’investissements massifs dans les infrastructures portuaires et ferroviaires, au nom de ses Nouvelles Routes de la Soie.
Mais la militarisation n’est pas seulement le fait de la Chine. Les États-Unis, via AFRICOM, maintiennent une présence active dans la région, centrée sur la lutte contre le terrorisme et la surveillance stratégique. La Turquie, elle, adopte une approche plus hybride : à la fois militaire, économique et culturelle. À Mogadiscio, elle forme des soldats somaliens, construit des infrastructures, et diffuse un imaginaire religieux et identitaire qui séduit certaines élites.
Au sud de la Corne, l’Éthiopie tente de s’imposer comme puissance régionale malgré ses déchirures internes. La construction du barrage de la Renaissance, projet hydroélectrique gigantesque sur le Nil, a ravivé les tensions avec l’Égypte, inquiète pour son accès à l’eau. Une rivalité entre deux puissances africaines qui attise les convoitises extérieures : la Turquie et les Émirats, en particulier, cherchent à s’y insérer en jouant des alliances fluctuantes avec les factions locales et les gouvernements en place. Dans ces interstices géopolitiques, les puissances étrangères lisent des opportunités. Les États, eux, cherchent à y échapper.
Car le jeu d’influence n’est pas qu’une affaire de déploiement stratégique. C’est aussi une bataille pour le récit. Djenabou Cissé le souligne en évoquant la bande sahélo-soudanaise, cet immense territoire de l’Atlantique à la mer Rouge, traversé par l’instabilité et la contestation politique. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la région est en proie à une reconfiguration violente : flux d’armes, effondrement de la Libye, affaiblissement des États, montée du jihadisme, interventions militaires étrangères — autant de facteurs qui ont fait du Sahel un terrain d’expérimentation géopolitique.
La France, puissance historique dans la région, a longtemps tenté d’y maintenir son influence par la force. L’opération Barkhane, les bases militaires, les coopérations sécuritaires… Mais tout cela s’est heurté à un rejet grandissant. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les gouvernements issus de putschs récents ont tous rompu avec Paris. Moins par affinité avec d’autres puissances que par rejet du modèle français. La Russie a su se glisser dans cette brèche. Avec Wagner hier — aujourd’hui rebaptisé « Africa Corps » — elle propose une aide militaire directe, une rhétorique anti-impérialiste, et des accords dans les secteurs miniers. Au Soudan, elle obtient des concessions d’or. Au Mali, elle sécurise le régime. Son approche repose sur une logique transactionnelle et sécuritaire, souvent brutale, mais efficace à court terme.
La Turquie joue une autre partition. Moins visible, mais tout aussi ambitieuse. Son armement, en particulier le drone Bayraktar TB2, s’est imposé comme un symbole de souveraineté pour certains régimes sahéliens. Ankara mise aussi sur l’influence religieuse, les bourses d’étude, les projets humanitaires. Le tout consolidé par une stratégie commerciale offensive : ses échanges avec le continent ont été multipliés par six en vingt ans.
Mais cette compétition féroce n’est pas seulement une importation de logiques extérieures. Elle rencontre une transformation intérieure profonde. Niagalé Bagayoko, politiste spécialiste des politiques de sécurité en Afrique, attire l’attention sur un basculement perceptible : le retour d’un discours panafricaniste, porté par les sociétés civiles, les jeunesses urbaines et certains courants politiques. Rejet des élites perçues comme inféodées, dénonciation des interventions étrangères, appel à la souveraineté économique : autant de thèmes qui bousculent les modèles classiques de coopération.
Ce néo-panafricanisme n’est pas uniforme. Il n’est pas toujours stable. Mais il marque une rupture. Une volonté de penser l’Afrique non plus comme un champ d’opérations, mais comme un acteur. C’est dans cette dynamique que des puissances africaines comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie ou l’Algérie cherchent à affirmer une autonomie. Le Nigeria, première économie du continent, joue un rôle clé dans la lutte contre Boko Haram et dans les négociations économiques régionales. L’Afrique du Sud, malgré ses crises internes, pèse au sein des BRICS. L’Algérie, riche de son indépendance énergétique, se positionne comme médiatrice régionale. L’Éthiopie, malgré ses conflits, abrite le siège de l’Union africaine et tente d’imposer sa voix sur les grands dossiers hydrauliques et régionaux.
Dans ce contexte mouvant, les grandes puissances extérieures ajustent leurs postures. La Chine continue de privilégier l’investissement économique, avec des projets phares comme la modernisation du port de Djibouti ou les infrastructures ferroviaires en Afrique de l’Est. Elle évite l’intervention militaire, tout en installant des outils de présence stratégique. La Russie combine hard power et mines. La Turquie tisse un réseau de fidélités multiples. Les États-Unis restent présents, mais leur capacité d’influence directe diminue. Et la France se voit contestée sur tous les fronts.
C’est cette bascule qu’il faut comprendre : l’Afrique n’est plus l’objet passif d’un jeu mondial. Elle devient le lieu d’une reconfiguration. Lieu de conflit, certes. Mais aussi de projection, de revendication, de réinvention. Les coups d’État militaires, les mouvements anti-français, les slogans de rue ne sont pas seulement des symptômes de rejet. Ils sont aussi, parfois, les prémices d’une volonté politique nouvelle.
Rien n’est stabilisé. Rien n’est assuré. Mais une chose est certaine : l’Afrique est en train de passer du statut de « zone d’enjeux » à celui d’acteur stratégique. Et cela change tout.