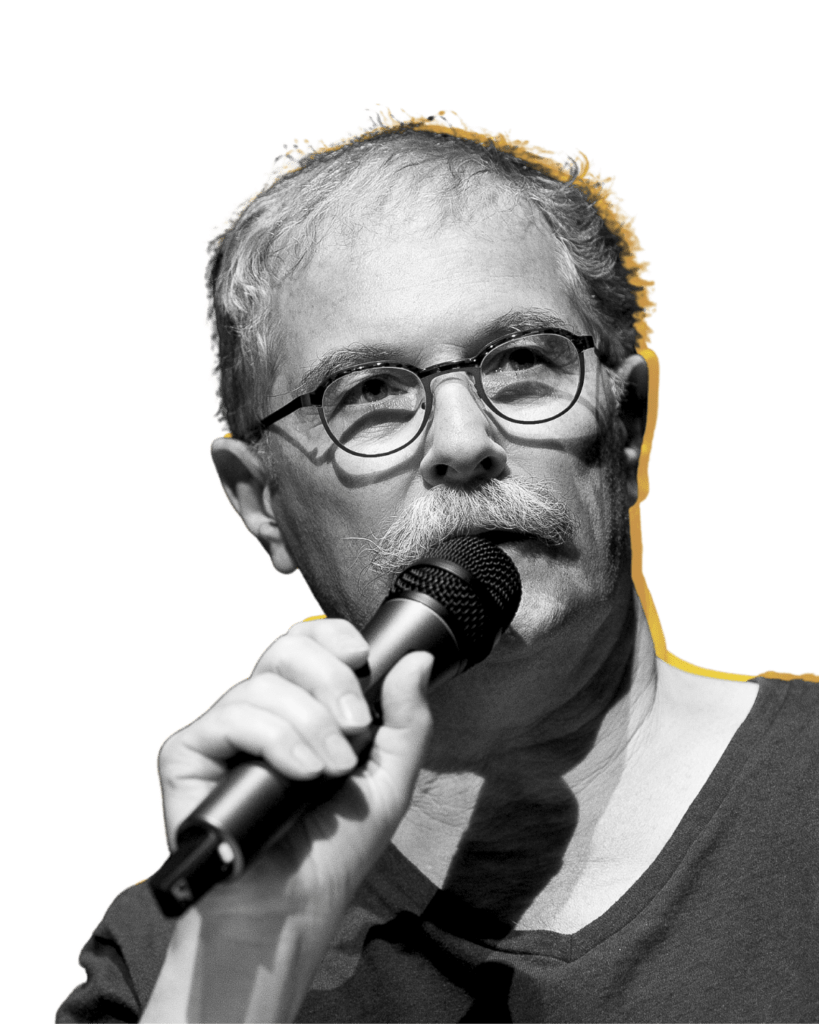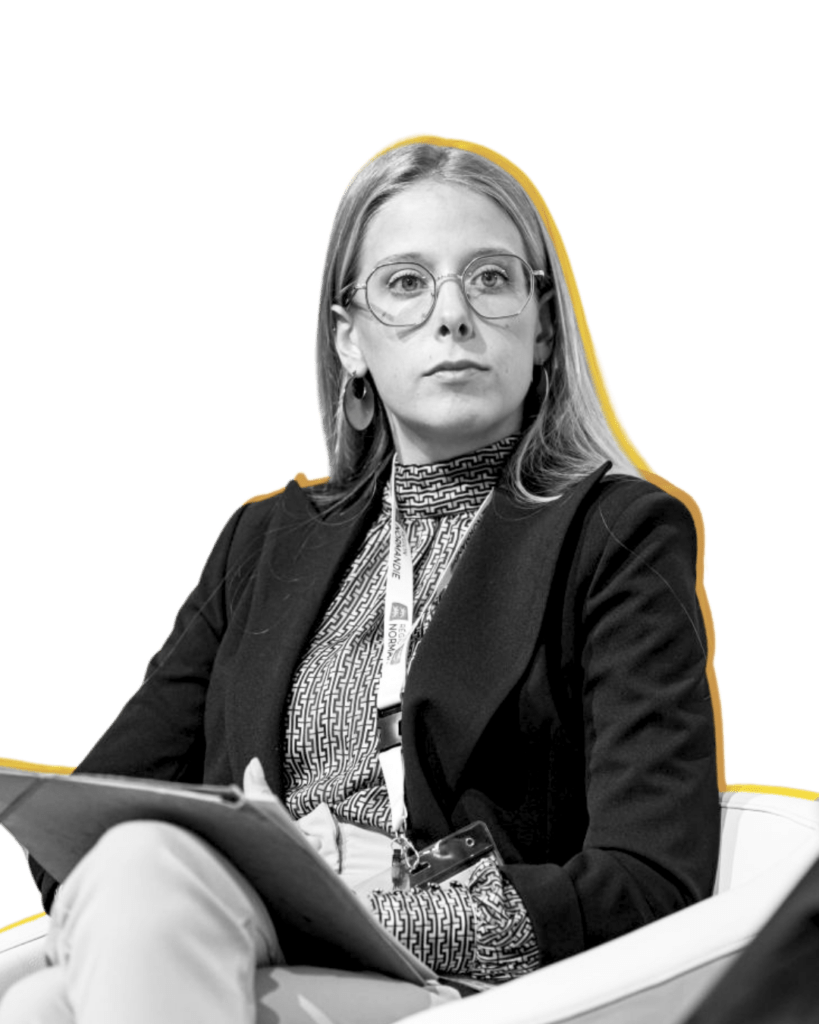Le tumulte du monde ne s’arrête plus aux frontières terrestres. À mesure que les conflits se multiplient, se prolongent, se déplacent, la mer redevient un terrain central, à la fois stratégique et symbolique. Pour l’amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine, il ne s’agit pas d’un simple déplacement du front : c’est une reconfiguration profonde des logiques de puissance. Là où l’on pensait stabilités, transit, communication, s’imposent désormais menaces, ruptures, frappes.
La conflictualité contemporaine ne se contente plus de naître sur terre pour déborder en mer : elle prend racine directement dans les profondeurs océaniques, sur les câbles sous-marins, autour des détroits, dans les zones économiques exclusives, aux abords des grands ports commerciaux. La mondialisation ne s’est pas contentée d’unir les économies : elle a aussi lié la sécurité des États à la fluidité de leurs flux maritimes. Et la guerre, elle aussi, s’est adaptée à cette réalité.
La guerre en Ukraine en offre un exemple saisissant. Au-delà des combats terrestres, c’est en mer Noire que les affrontements ont révélé une bascule stratégique : une marine ukrainienne numériquement inférieure a réussi à tenir tête à une puissance maritime comme la Russie, en adaptant ses méthodes. Plutôt que d’imiter la puissance, elle l’a contournée. En ciblant les faiblesses — notamment l’autodéfense des navires — l’Ukraine a illustré ce que l’amiral Vaujour appelle une logique d’agilité offensive, fondée sur l’initiative, la mobilité, et la ruse stratégique. Un enseignement que la France doit savoir entendre.
Même dynamique en mer Rouge, devenue en quelques mois un espace d’insécurité permanente. Les attaques répétées des Houthis sur des navires commerciaux et militaires, souvent grâce à des drones et missiles de fabrication iranienne, ont démontré que des acteurs non étatiques sont aujourd’hui capables d’entraver des routes commerciales globales. Cette capacité, même partielle, suffit à perturber les équilibres régionaux. L’amiral souligne un point clé : même si le taux de réussite militaire de ces attaques est faible, leur impact politique et logistique est considérable. C’est un changement de paradigme : désormais, l’incertitude suffit à dominer une zone maritime.
Cette reconfiguration ne touche pas que les marges. Elle engage des États qui, historiquement, se définissaient comme des puissances continentales. La Chine, notamment, a opéré un tournant stratégique sans précédent vers la mer. Sa croissance économique, ses ambitions diplomatiques, sa sécurité énergétique et commerciale dépendent de sa capacité à garantir l’accès à ses routes maritimes. Les Routes de la soie, qu’elles soient terrestres ou maritimes, en sont l’expression concrète. Des ports chinois sont aujourd’hui contrôlés ou financés dans plus de 50 pays. Pékin a compris que l’économie mondiale se joue en mer. La dissuasion aussi.
L’Inde, de son côté, ne dissimule plus ses ambitions maritimes. Longtemps tournée vers l’intérieur, elle revendique désormais un rôle stabilisateur dans l’océan Indien, investit dans la modernisation de sa marine et multiplie les exercices conjoints avec les États-Unis, le Japon ou la France. Ce réveil maritime des puissances asiatiques redéfinit les équilibres navals mondiaux. Pour l’amiral Vaujour, cela impose à la France de renforcer sa présence dans des zones où son influence est encore limitée, comme le Pacifique ou l’océan Indien occidental.
Face à ce monde instable, la Marine nationale ne peut rester figée. Sa force repose aujourd’hui sur trois piliers : une présence mondiale, une capacité de frappe rapide et une adaptation technologique permanente.
Son format, conçu pour durer plusieurs décennies, impose d’intégrer l’innovation en temps réel. L’amiral prend l’exemple d’un navire de guerre construit pour quarante ans : son efficacité dépendra de sa capacité à accueillir des évolutions technologiques successives, sans attendre le cycle industriel classique. Cela suppose une collaboration étroite avec les industriels, une culture de l’expérimentation en opération, et une agilité décisionnelle à tous les niveaux.
Le rôle de l’intelligence artificielle devient ici crucial. Il ne s’agit pas de robotiser la guerre, mais de renforcer l’aptitude humaine à décider vite, à exploiter l’information, à sécuriser les systèmes. L’IA permet de détecter plus tôt, de réagir plus vite, de coordonner plus efficacement. Et elle transforme aussi la préparation : la simulation, la formation, la maintenance prédictive changent les méthodes de commandement.
Mais l’élément humain reste décisif. L’amiral insiste : la guerre reste un affrontement de volontés, pas seulement de moyens. Les marins français doivent être capables de prendre l’initiative dans des délais toujours plus courts, de s’adapter à des environnements instables, de coopérer avec des alliés aux cultures opérationnelles diverses. C’est un savoir-faire exigeant, presque artisanal, acquis par l’entraînement, par la mer, et par la permanence de l’engagement.
La conflictualité actuelle n’est pas seulement technologique. Elle est aussi psychologique et politique. L’amiral évoque la montée d’un climat de désinhibition généralisée, où l’usage de la violence n’est plus entouré des mêmes limites. L’attaque iranienne contre Israël le 1er octobre 2024 (plus de 200 missiles tirés) en est une illustration. La logique de la démonstration de force prime désormais sur celle de la retenue. Le modèle occidental de gestion diplomatique des conflits est remis en cause — souvent perçu comme inefficace ou hypocrite.
Ce retour du rapport de force met en lumière le rôle crucial de la dissuasion. Pour la France, la force de dissuasion océanique est un pilier de la stratégie nationale. Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) garantissent une capacité de riposte invisible et permanente. L’amiral Vaujour rappelle que la dissuasion n’est pas une arme d’usage, mais une assurance de stabilité, un levier d’influence, une manière de peser dans un monde où les équilibres sont mouvants.
Mais les tensions géopolitiques ne sont pas les seuls défis. Les bouleversements environnementaux redessinent la carte des océans. La fonte des glaces aux pôles ouvre de nouvelles routes maritimes, réactive d’anciennes rivalités territoriales, pose la question de la protection des écosystèmes et de la sécurisation des infrastructures. En 2018 déjà, une mission française avait constaté l’accélération du phénomène. Depuis, la montée des eaux, l’acidification des océans et les risques climatiques modifient les conditions mêmes de la projection navale.
La Marine française doit donc être aussi une force de veille et d’anticipation. Elle contribue à la protection des littoraux, à la lutte contre la pollution, à la sécurisation des zones économiques exclusives. Ce travail quotidien, souvent invisible, est essentiel à la résilience de la France.
Pour relever l’ensemble de ces défis, la Marine française modifie sa posture. L’amiral le dit sans détour : il faut être prêt à frapper le premier. Non pas par volonté d’agression, mais par nécessité de conserver l’initiative. Cela suppose une agilité extrême, une capacité à intégrer rapidement les nouvelles technologies, mais aussi à projeter des forces dans des délais très courts.
C’est aussi dans cette logique que s’inscrivent les exercices internationaux, comme celui conduit en 2024 entre la Bretagne et Hawaï, avec plus de 30 marines partenaires. Dans un monde multipolaire, la coopération ne doit plus être une formalité, mais un levier d’action. Savoir travailler ensemble, partager les données, adapter les procédures : c’est cela, désormais, la condition de l’efficacité stratégique.
La mer, autrefois perçue comme un espace de respiration stratégique, est aujourd’hui saturée de tensions, de flux, de signaux faibles. Elle est le miroir du monde : instable, disputée, fragmentée. Et c’est sur elle que se joue, de plus en plus, l’avenir des puissances.
Pour la France, la Marine nationale n’est pas seulement une composante militaire. Elle est un outil politique, diplomatique, économique, environnemental. Elle incarne la souveraineté, la permanence, la réactivité. Et dans cette époque où les équilibres se déplacent vite, elle sera l’un des piliers de la capacité d’action de l’État français. Pas seulement en mer, mais dans le monde.