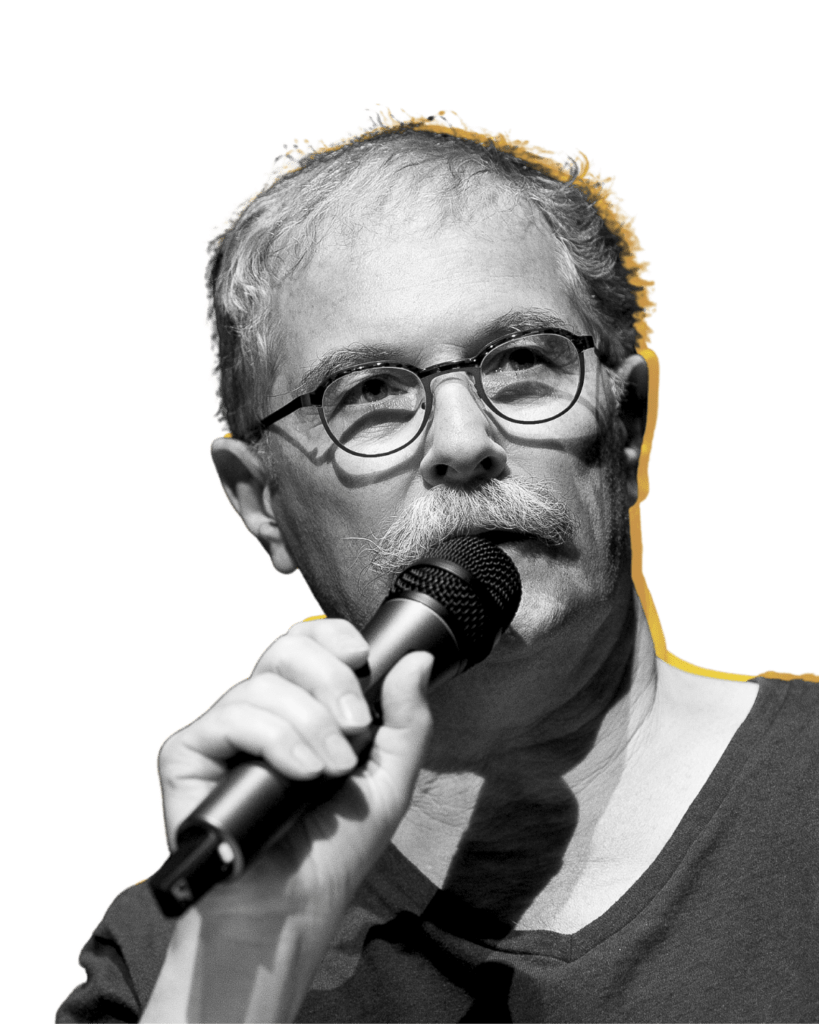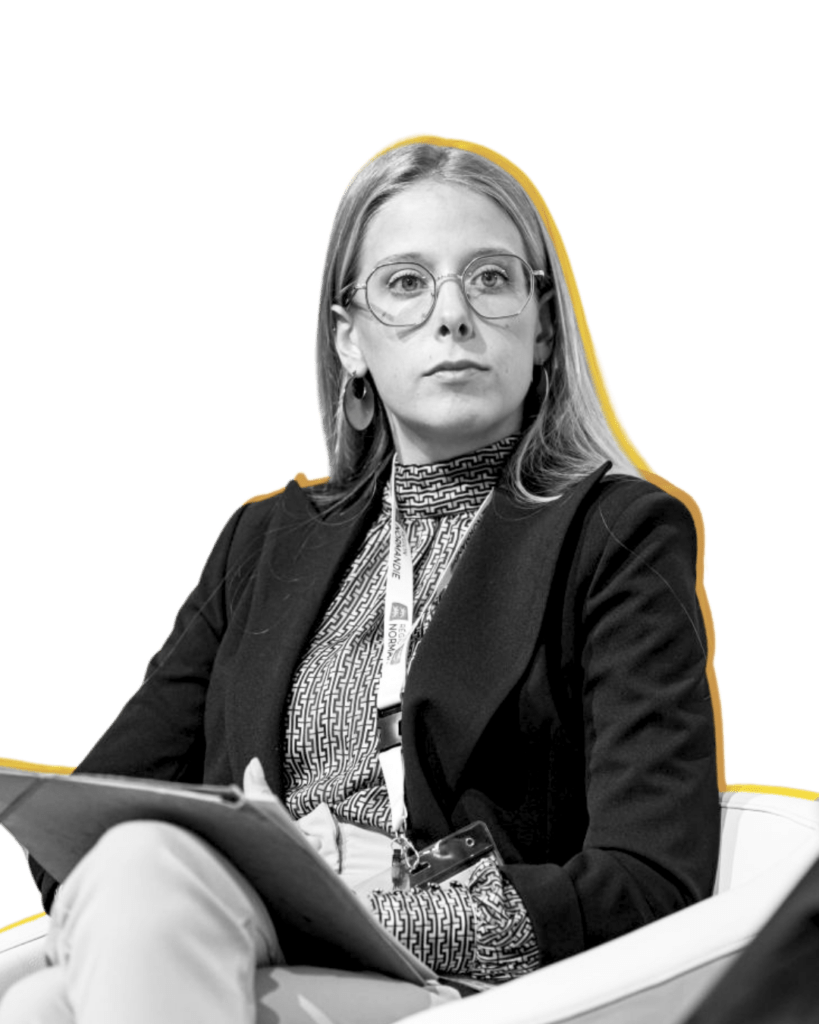Le terme revient, discret mais tenace, dans les discussions stratégiques contemporaines : recomposition. Ce n’est plus le monde d’avant, mais ce n’est pas encore un monde nouveau. Les grandes puissances, loin de s’opposer frontalement, avancent à tâtons dans un champ de tensions mouvant, entre récits concurrents, affirmations identitaires et renversements d’alliances. La puissance n’est plus une posture affichée. Elle est devenue une capacité à durer, à s’adapter, à raconter une continuité face au chaos. Et dans ce jeu incertain, quatre trajectoires se détachent : les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, chacune cherchant à imposer sa vision de l’ordre sans jamais totalement y croire.
Laurence Nardon, chercheuse à l’IFRI et spécialiste des États-Unis, ouvre cette lecture par une observation centrale : les États-Unis ne manquent pas de moyens pour peser, mais d’un cap pour les orienter. L’économie, l’innovation, le soft power, le militaire, même la justice extraterritoriale restent des leviers puissants. Mais la société américaine, fracturée, hésite entre trois lignes de force : celle des centristes interventionnistes de l’administration Biden, héritiers d’un internationalisme libéral ; celle de la droite trumpienne, adepte d’un repli assumé ; et celle, plus récente, d’une gauche qui préfère renoncer à l’ingérence pour reconstruire la cohésion intérieure. Cette tension interne n’est pas simplement idéologique : elle conditionne la capacité de l’Amérique à incarner un rôle stratégique cohérent. Pendant ce temps, le monde avance, sans elle ou malgré elle.
C’est dans ce vide partiel que s’engouffre la Chine. Emmanuel Puig, directeur adjoint Asie à l’IRIS, en donne une lecture à la fois institutionnelle et géopolitique : Xi Jinping a profondément modifié la nature du régime depuis son arrivée au pouvoir en 2012. En abolissant la limite des mandats en 2022, il a réinstallé un pouvoir centralisé, verrouillé idéologiquement et paranoïaque envers les influences extérieures. Mais ce raidissement intérieur n’entrave pas, au contraire, la projection stratégique de Pékin. Chaque geste de politique étrangère, de la multiplication des bases logistiques à Djibouti au déploiement des Nouvelles Routes de la Soie, répond à une logique de long terme : celle de modifier l’équilibre mondial sans provoquer de rupture brutale. La Chine n’affronte pas, elle encercle. Elle ne nie pas l’ordre existant, elle l’infléchit de l’intérieur. Son soft power se manifeste dans les infrastructures, dans les normes, dans les dépendances — pas dans les slogans.
Mais ce récit d’ascension tranquille masque aussi une fébrilité. Le marché intérieur ne suit plus. La démographie inquiète. L’opinion se durcit. Le pacte post-Tiananmen — tu laisses le Parti gouverner, il te garantit la prospérité — ne tient plus ses promesses. La Chine renforce alors sa posture sécuritaire et nationaliste, pour contenir un désenchantement latent. Dans ce contexte, la rivalité avec les États-Unis devient structurante, presque nécessaire : elle légitime l’autorité interne tout en donnant un cap à l’action extérieure. Le théâtre principal de cette tension est désormais l’Indo-Pacifique, là où l’ancienne théorie du « rimland » prend aujourd’hui tout son sens stratégique.
Sur l’autre rive de l’Eurasie, Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique, observe une Russie en lutte contre sa propre marginalisation. Le pouvoir de Vladimir Poutine, renforcé symboliquement par l’intervention en Syrie, cherche à montrer que la guerre en Ukraine n’a pas fissuré l’édifice. L’opposition est réduite au silence, l’économie tient grâce aux hydrocarbures, et la population, nourrie à une propagande anti-occidentale depuis plus de vingt ans, continue d’adhérer au récit officiel. Mais cette stabilité n’est qu’apparente : la Russie sait qu’elle ne peut plus imposer l’ordre, alors elle le perturbe.
Ses instruments sont ceux du « sharp power » : campagnes de désinformation, instrumentalisation des fractures sociétales en Europe, réorientation du soft power vers un discours conservateur et anti-libéral, comme en témoigne l’épisode des tags antisémites en France à l’automne 2023. Moscou s’invente comme rempart moral face à un Occident jugé décadent. Elle s’insère dans les coalitions alternatives — BRICS, Organisation de coopération de Shanghai — et cherche dans sa proximité avec Pékin un soutien qui lui échappe souvent. Car la Russie, aujourd’hui, est dans une logique d’association déséquilibrée : elle a besoin de la Chine plus que la Chine n’a besoin d’elle. Et cela reconfigure en profondeur ses prétentions stratégiques.
Pendant ce temps, une autre puissance trace sa route, sans faire de bruit mais sans reculer non plus. Melissa Levaillant, directrice de recherche à l’Institut FMES, décrit une Inde à la fois discrète et déterminée. Depuis 2014, l’arrivée au pouvoir du BJP de Narendra Modi a changé la tonalité sans bouleverser la ligne. L’Inde ne se cherche pas un camp : elle construit sa propre position. Exit le non-alignement des années Nehru, place au « multi-alignement » pragmatique : un partenariat renforcé avec les États-Unis, des liens conservés avec la Russie, une coopération en matière de défense avec la France, et une stratégie affirmée en Indo-Pacifique.
Mais derrière cette montée en puissance, les failles internes sont nombreuses : chômage des jeunes, manque de qualification de la main-d’œuvre, économie encore trop rurale. La Chine, elle, reste la principale inquiétude. Par sa stratégie du « collier de perles », Pékin tente d’encercler l’Inde via des alliances portuaires et logistiques dans l’océan Indien. Sur terre, les tensions frontalières s’intensifient, notamment dans l’Arunachal Pradesh. En réponse, New Delhi renforce ses capacités militaires depuis 2020, déploie une diplomatie active autour du projet IMEC, lancé au G20 en 2023, et s’implique dans la cybersécurité via des partenariats avec Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis. L’Inde se positionne comme un acteur stabilisateur, mais sans jamais épouser les cadres occidentaux — préférant parler de « partenariat stratégique préférentiel » plutôt que d’alliance.
Au fond, ce qui se donne à voir dans ces trajectoires croisées, ce n’est pas une bataille rangée entre blocs rivaux, mais un ajustement permanent. Les États-Unis doutent d’eux-mêmes, la Chine construit une lente hégémonie, la Russie compense par la perturbation, et l’Inde tente l’équilibre dans un jeu asymétrique. Aucun n’impose sa vision, tous cherchent à préserver leur capacité d’action.
Quand on interroge les intervenants sur ce que chaque puissance redoute le plus, les réponses en disent long : Laurence Nardon estime qu’une victoire de Donald Trump ne serait pas nécessairement le pire scénario pour Washington — ses méthodes, brutales, peuvent paradoxalement produire des effets inattendus. Emmanuel Puig évoque la hantise de Pékin de voir son partenaire russe s’effondrer face à l’Ukraine, ou pire, Taïwan s’armer de l’arme nucléaire. Isabelle Facon pointe une crainte russe plus diffuse, mais tout aussi existentielle : celle d’une entente implicite entre Washington et Pékin, qui marginaliserait définitivement Moscou.
Car c’est peut-être là, dans les angles morts de ces stratégies, que se joue l’essentiel. La puissance ne réside plus dans l’accumulation brute des moyens. Elle se joue dans la manière dont chaque acteur parvient à inscrire sa propre trajectoire dans les structures du monde. Dans ce grand récit concurrentiel, nul n’a encore trouvé la dernière phrase.