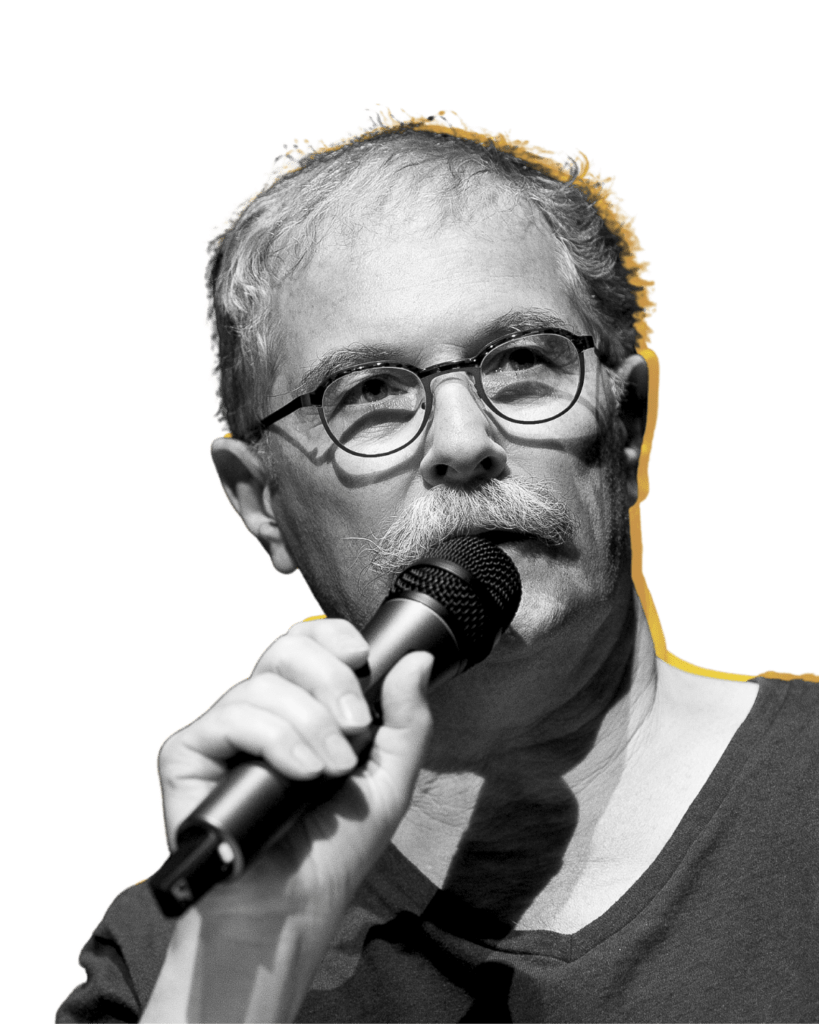À l’origine de la centralisation du pouvoir
À la sortie de la dernière glaciation, un réchauffement climatique majeur bouleverse les écosystèmes. Les forêts s’étendent, les graminées prospèrent sur des terres nouvellement devenues fertiles. Jusque là, les populations de chasseurs-cueilleurs étaient nomades, vivaient en petits groupes relativement égalitaires, et se déplaçaient opportunément au gré des ressources saisonnières et des migrations animales. Leur économie était adaptative (en « flux tendus », en quelque sorte) et ils prélevaient dans la nature uniquement ce dont ils avaient besoin – sans faire de stock.
Mais il y a environ 10 000 ans, petit à petit et par tâtonnements, ces populations commencent à expérimenter le modelage de la nature par la domestication. En quelques milliers d’années, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades se transforment en agriculteurs, moissonneurs et éleveurs de bétail, bref, en Homo sapiens sédentaires. C’est le début de ce que l’on appelle parfois la « révolution Néolithique ».
En s’émancipant des aléas de ce que leur environnement voulait bien lui céder et en apprenant plutôt à le contrôler, l’être humain accomplit pour la première fois un pas décisif vers son extirpation durable de la nature, et réimagine foncièrement sa relation au vivant. Comme toute révolution, ce passage fait naître de nouveaux défis sociétaux et donne lieu à une organisation nouvelle.
Dans ces sociétés, une division du travail et une hyper-spécialisation des rôles se mettent très vite en place (agriculteurs, éleveurs, artisans, prêtres, chefs). Ces choix organisationnels politiques permettent d’une part d’optimiser la productivité des ressources nécessaires à la survie de ces communautés grandissantes, et d’autre part d’encourager les innovations techniques allant dans ce sens (les artisans développent la céramique pour le stockage, la fusion du cuivre pour les outils et les armes, les systèmes d’irrigation pour les champs de cultures).
Les céréales comme le blé, le riz, et le maïs, qui nourrissent dorénavant ces nouvelles sociétés sédentaires à travers le monde, sont profusément cultivées et récoltées. Et pour la première fois, des stocks importants de ces richesses agro-alimentaires se constituent. Ces excédents de production qu’il faut gérer, monnayer et défendre, permettent rapidement à des strates sociales de s’imposer : certaines « élites » politiques et religieuses commencent à contrôler ces biens tant convoitées (ainsi que leurs moyens de production), tandis que des groupes de guerriers se chargent de les défendre contre les attaques rivales. Les fouilles archéologiques dans certaines régions montrent d’ailleurs une nette explosion de la violence à cette période, engendrée par la lutte tribale pour le contrôle des ressources ainsi que par les inégalités sociales ayant émergé entre les différentes couches de la société.
Mais de part l’hyperspécialisation des rôles et de l’interdépendance qui en découle, et malgré un système de redistribution de la richesse profondément inéquitable, ce contrôle hautement centralisé des ressources stratégiques donne lieu à une interdépendance entre la masse et ses « classes » dirigeantes. Petit à petit, un nouvel ordre hiérarchique voit le jour, dont la plupart de nos sociétés actuelles sont les héritières directes.
L‘éclosion des oligarchies numériques
Bien que les greniers à grains aient laissé place aux greniers à données (serveurs, datacenters), et que les récoltes se déroulent maintenant sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes numériques de commerce, ces mécanismes de gouvernance proto-féodale entrent étonnement en résonance avec le monde numérique d’aujourd’hui.
Les grandes entreprises technologiques telles que les GAFAM (Google-Alphabet, Apple, Facebook-Meta, Amazon, Microsoft) réinventent et reconfigurent les rapports de pouvoir entre la population consommatrice d’informations, et ces élites qui se les approprient à leur profit. Ces géants du web détiennent aujourd’hui la quasi-totalité des ressources numériques mondiales, et bénéficient ainsi du pouvoir qui en découle. C’est en collectant, en analysant et en monétisant ces denrées précieuses, que ces « empires de la surveillance » (tels que les appelle la sociologue américaine Shoshana Zuboff) prospèrent et exercent un contrôle permanent sur nos vies quotidiennes.
Ce phénomène est rendu possible par la sur-technologisation de tous les domaines de la vie quotidienne moderne (smartphones, dématérialisation globale des données, intelligences artificielles, Internet of Things, etc) et par l’hyperdépendance que l’on entretient avec elle. Et tout comme au Néolithique, ce phénomène de concentration des pouvoirs et de dépendance vis-à-vis de ces organisations met à mal notre souveraineté individuelle et collective.
Tout comme l’avènement des chefferies agricoles a provoqué petit à petit la perte de la maîtrise collective de la vie citoyenne au profit d’une autorité centrale, les individus se voient aujourd’hui dépossédés de leur pouvoir sur leurs propres données personnelles. Et plus grave encore, ils se trouvent parfois subordonnés à la modération numérique et à la censure gouvernementale (e.g. La Chine de Xi Jinping). Et s’il semble évident que l’accès à l’information est souvent la première victime des oligarchies, il en est également son premier moteur : les campagnes de manipulation de l’opinion publique sont devenues monnaie courante et montrent que la technologie peut maintenant être efficacement utilisée pour orienter des décisions démocratiques. Les études sérieuses à ce sujet ne manquent pas, et permettent notamment de mettre en lumière l’exploitation de données personnelles pour influencer des intentions de vote (comme ce fut le cas avec le scandale Facebook-Cambridge Analytica), ou encore l’influence massive des armées de bots (faux comptes automatisés) ayant par exemple relayé de fausses informations sur Twitter avant les élections étasuniennes de 2016.
Mais ne sacrifions pas la moisson à cause d’un mauvais épi : ces géants de la tech nous rendent aussi la vie plus facile. Tout comme les classes guerrières qui veillaient autrefois au grain et qui dispensaient la masse productrice de la pénible corvée de défense de leurs terres, les entreprises technologiques allègent aussi notre quotidien. Elles automatisent de nombreuses tâches fastidieuses, permettent de rester en contact avec nos proches, mais aussi de collaborer au-delà des frontières et de partager des informations en un temps record. Les réseaux sociaux – ces sortes de structures tribales où chacun cherche sa famille symbolique – peuvent aussi donner naissance à de belles avancées démocratiques. Souvenons-nous des manifestations historiques qui ont eu lieu après la mort de Mahsa Amini en 2022 et qui ont permis de mettre en lumière la misogynie systémique de la loi iranienne et son impunité policière, ou encore la Révolution du jasmin en 2010 qui a enclenché depuis la Tunisie la grande marche du Printemps arabe. Ce sont des plateformes comme Twitter ou Instagram qui ont permis d’orchestrer ces manifestations et de documenter en direct les dérives gouvernementales. Il n’a jamais été aussi facile de coordonner des soulèvements populaires, et jamais été aussi accessible de développer notre conscience collective et politique.
Mais la position quasi-monopolistique d’une poignée d’acteurs privés dont le seul but est l’amas de ressources et de capital fossilise des dynamiques de contrôle absolu dont l’Histoire nous a déjà maintes fois montré les dérives. Ce « techno-féodalisme » (terme proposé par l’économiste et sociologue Cédric Durand) dessert globalement notre intérêt individuel et social. En définissant les dynamiques de contrôle absolu sur les ressources
Lorsque nous parcourons notre feed (il est d’ailleurs difficile de ne pas voir l’ironie de ce terme anglais qui renvoie au champ lexical de l’alimentation), l’information de masse que l’on y consomme est déjà algorithmiquement tamisée, prémâchée et tristement addictive, et cette hyperdépendance entretient notre aliénation à un système qui nous exploite. Si nous imaginons internet comme une vaste cantine informationnelle où nous nous servons en fonction de nos envies et de nos besoins, nous nous complaisons dans l’illusion. Les algorithmes de recommandation des moteurs de recherches et des réseaux sociaux limitent grandement la marge de manœuvre individuelle en nous exposant presque exclusivement à des informations et à des points de vue qui confirment nos opinions.
Ce tribalisme numérique nous enferme ainsi dans une « bulle de filtrage », c’est-à-dire une réalité numérique cohérente mais fortement biaisée, qui, sans jamais nous exposer à une diversité d’opinions, nous conforte simplement dans notre vision du monde. Par conséquent, comment imaginer que la qualité du débat démocratique ne pâtisse pas d’une recette basée sur le sensationnalisme, les trends et les pièges à clics ? Ce pouvoir d’influence centralisé et partisan, sur lequel le citoyen lambda n’a aucun pouvoir apparent, met à mal les principes mêmes du débat démocratique et entache notre droit fondamental à la liberté de recevoir des informations sans contraintes (article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948).
L’éducation numérique, un outil de lutte contre la nouvelle illusion démocratique
À la différence des cas de figure (pré-)historiques évoqués plus haut dans lesquels les masses productrices sont volontairement maintenues dans l’ignorance, une part grandissante de la population mondiale a maintenant accès aux outils numériques en ligne. Tout citoyen du 21e siècle ayant accès aux réseaux sociaux ou aux médias en ligne a l’illusion d’être correctement informé, de détenir la vérité, et d’orienter ses choix politiques en toute connaissance de cause. Et si la fracture numérique entre citoyens connectés et déconnectés à l’échelle mondiale reste encore colossale, il semblerait que le danger viennent surtout du clivage existant au sein même des individus connectés.
Car force est de constater que la plupart de la population connectée est aussi très peu formée à la compréhension des mécanismes qui se cachent derrière les informations auxquelles elle a accès, et à l’identification des dérives algorithmiques des géants de la tech. Il y a ceux qui savent manier les outils numériques (aisance avec les machines et les logiciels), qui vérifient leurs sources, qui ont pu développer un esprit critique affûté, et qui s’exposent volontairement à des points de vue divergents. En bref, qui ne sont pas des consommateurs crédules d’informations en ligne. Et il y a les autres, en réalité la grande majorité des citoyens connectés. Ceux-ci présentent encore un trop faible niveau de littératie numérique, n’ont souvent pas assez de recul sur la nourriture numérique qu’on leur donne, et paradoxalement, vivent souvent dans l’illusion d’être bien informé.
Cette illusion démocratique est pernicieuse, car elle donne l’impression aux citoyens qu’ils ont plus de pouvoir qu’ils n’en ont en réalité. Cette chimère populaire les rend ainsi naturellement moins enclins à revendiquer des droits ou à entamer des actions de défense politique concrètes. Qui n’a jamais signé une pétition en ligne pensant user stratégiquement de son droit civique ? Alors que pendant ce temps, les véritables lieux de pouvoir (que sont les conseils d’administration des GAFAM, ou encore les institutions gouvernementales nationales ou internationales, où des illettrés du numérique négocient ensemble… les régulations du numérique) restent encore très largement hors de portée du grand public.
Pourtant, le maniement critique de ces outils numériques — puissants mais fortement biaisés — est une condition sine qua non à la prise de décisions citoyennes intègres et à la maîtrise de son destin civique, et c’est pourquoi la lutte contre l’illectronisme sera certainement un enjeu fondamental des générations à venir.
En profitant d’un cadre juridique international flou, les géants du web continuent à amasser sans vergogne les ressources que nous générons. Le plus alarmant étant que cette concentration de pouvoir dépasse souvent, et à bien des égards, la puissance des États. Cet accaparement de l’autorité par une élite non-étatique altère le contrat social démocratique : qui commande ? Pour qui ? Pour quoi ? La démocratie à l’heure du numérique doit se penser avant tout comme un processus de décentralisation — du pouvoir, et donc des données.
Grâce à internet et à la prodigieuse globalisation des savoirs, nous avons maintenant la chance de pouvoir prendre du recul sur les mécanismes complexes d’assujettissement à travers le temps long (comme la néolithisation, la féodalisation). L’introspection historique pourrait peut-être s’avérer une bonne alliée pour nous libérer du joug de nos maîtres de la tech, et pour nous aider à repenser de nouvelles dynamiques démocratiques qui s’appliqueraient à l’ère du tout-digital. En tout cas, c’est peut-être sur ce terrain que se cultivera notre prochaine révolution néo-numérique.